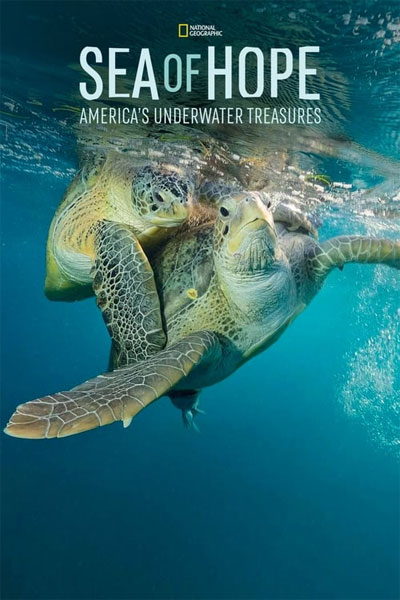De l'Espoir sous l'Océan
|
Titre original : Sea of Hope : America's Underwater Treasures Production : National Geographic True Blue Films Date de diffusion USA : Le 13 janvier 2017 Genre : Documentaire |
Réalisation : Robert Nixon Musique : Will Bates Durée : 47 minutes |
Le synopsis
 |
La critique
Vastes étendues d’eau salée recouvrant environ soixante-dix pour cent de la surface de la Terre, les cinq océans sont des merveilles de la nature permettant à la vie de prospérer. Il s’agit dès lors d’un trésor qu’il convient coûte que coûte de protéger contre l’ensemble des menaces qui pèsent sur lui.

Aujourd’hui plus que jamais, les océans sont des espaces en danger. La pêche industrielle, l’exploitation des minerais, les forages de pétrole, le réchauffement climatique et la simple croissance démographique mondiale exercent en effet une pression jusqu’alors inégalée sur les milieux marins et sous-marins. Des poissons tels que le menhaden, le mérou, le poisson-perroquet ou le thon rouge font partie des grandes victimes de la surpêche. Leur perte entraîne un risque de brisure nette au sein de la chaîne alimentaire. Quatre-vingt-dix pour cent des grands poissons ont pour leur part d’ores et déjà disparu. Les coraux meurent à une vitesse inimaginable. Les espèces vivant au plus profond des océans ne sont pas épargnées, en particulier à cause des forages toujours plus profonds.

Malgré leur caractère vital, les espaces maritimes demeurent pourtant les parents pauvres de la politique de protection de l’environnement lancée dès la fin du XIXe siècle aux États-Unis. À l’époque, l’Amérique constate avec amertume la disparition totale de certaines espèces comme les grands pingouins, les tourtes voyageuses et les wapitis de l’est. Les bisons sont eux-mêmes au seuil de leur extinction. En 1871, William Henry Jackson, un vétéran de la Guerre de Sécession, est choisi comme photographe officiel de l’expédition dirigée par Ferdinand Hayden dans le Wyoming. L’objectif est alors de rapporter des clichés de l’Ouest sauvage afin de sensibiliser les populations. Magnifiques, les photographies réussissent surtout à convaincre le président de l’époque, Ulysse S. Grant, de fonder le premier parc national du monde, Yellowstone.

La plupart des présidents suivants ont ensuite marché dans les pas de Grant. Le 25 août 1916, Woodrow Wilson signe une déclaration donnant pour mission au tout nouveau National Park Service de conserver et protéger les paysages, les sites naturels et historiques, la faune et la flore du pays dans le but de les transmettre aux générations futures. En 1933, Herbert Hoover paraphe le Reorganization Act permettant au gouvernement fédéral de transférer la gestion des monuments nationaux d’un organisme à un autre. Celui-ci est utilisé pour la première fois par Franklin Roosevelt qui décide de retirer la gestion des sites de la Guerre de Sécession au Département de la Guerre pour les confier au National Park Service. Les monuments nationaux gérés par le Département de l’Agriculture sont également concernés. En 1952, Dwight D. Eisenhower renforce l’équipement des parcs. En 1961, John F. Kennedy met en lumière la nécessité de consacrer les mêmes efforts au littoral et à la mer. En 1982, Ronald Reagan étend l'idée à 320 kilomètres au large des côtes.

Pour l’heure simplement effleurée, la protection des océans au même titre que les monuments nationaux est le combat d’une vie menée par l’exploratrice et océanographe Sylvia Earle. Surnommée « La Reine des profondeurs » - « Her Deepness » - par The New Yorker, elle voit le jour le 30 août 1935 à Gibbstown, dans le New Jersey. Dès le plus jeune âge, elle est encouragée par ses parents, Alice et Lewis, à explorer et à aimer la nature. Sensibilisée à la question environnementale, elle grandit à Dunedin, en Floride. Menant des études au St. Petersburg College, elle poursuit son cursus à l’Université d’État et décroche une licence en sciences en 1955, suivie par un master l’année suivante, et enfin un doctorat en phycologie en 1966. Un temps chargée de recherche à l’Université Harvard, Sylvia Earle dirige le Laboratoire Marin de Cape Haze et prend la tête du projet Tektite II, un laboratoire sous-marin créé au large des îles Vierges. Durant deux semaines, elle constate les effets de la pollution sur les récits coralliens. Détentrice en 1979 du record féminin de plongée lors d’une descente à 381 mètres de profondeur, elle travaille pour l’Académie des sciences de Californie. Cofondatrice avec son mari Graham Hawkes de l’entreprise Deep Ocean Engineering, elle est nommée directrice scientifique de la National Oceanic and Atmospheric Administration. En 1998, elle devient « exploratrice à demeure » pour le National Geographic.

Couronnée par de très nombreux prix et autres distinctions, notamment la médaille de l’Explorers Club et le titre de Légende vivante remis par la Bibliothèque du Congrès en 2000, Sylvia Earle milite depuis le début de sa carrière pour la création d’aires marines protégées tout autour du globe qu’elle baptise « Hope spots ». Elle est soutenue dans sa démarche par plusieurs personnalités au nombre desquelles figure Max Kennedy, le fils de Robert et Ethel Kennedy, et neveu du président John Kennedy. Earle est également accompagnée par Brian Skerry, l’un des meilleurs photographes de la vie sous-marine ayant, entre autres, fait les belles heures de la revue National Geographic avec des clichés merveilleux.

Dans ses expéditions récentes, Sylvia Earle est également accompagnée par une partie des équipes de National Geographic et par le réalisateur Robert Nixon. Né en 1954, il grandit dans la banlieue de Philadelphie avant que ses études et ses recherches le mènent jusqu’en Angleterre, où il travaille comme fauconnier, puis au Guyana où il passe plusieurs semaines à tenter de photographier l’aigle orné et la harpie féroce. De retour aux États-Unis, Nixon imagine un plan de préservation des rapaces, ses animaux fétiches qu’il immortalise dans des documentaires comme The Falconer (1977), Endangered Spacies (2004). En 1979, il accompagne Dian Fossey lors de l’une de ses expéditions au Rwanda. Sympathisant avec la jeune femme, il obtient d’elle le droit de raconter sa vie au cinéma. L’émotion autour de l’assassinat de Fossey en 1985 termine de convaincre Universal Pictures et Warner Bros. de s'associer pour mettre en chantier Gorille dans la Brume (1988), le long-métrage de Michael Apted coproduit par Nixon. Nommé pour l’Oscar du Meilleur Court-Métrage pour Amazon Diary (1989), le documentariste complète sa filmographie avec America the Beautiful (1990), Mission Blue (2014), Shark Week (2012-2016) et De l’Espoir Sous l’Océan (2017).

Dans De l’Espoir Sous l’Océan, Robert Nixon accompagne Sylvia Earle aux quatre coins des eaux territoriales des États-Unis. Le réalisateur commence tout d’abord par poser ses caméras à Cashes Ledge, une chaîne de montagnes sous-marines située au large de la Nouvelle-Angleterre et où la pêche intensive est en train de détruire l’espèce de poissons menhaden. L’exploration se poursuit à 320 kilomètres de là, dans les canyons et autres reliefs bordant le plateau continental américain. Le voyage emporte ensuite les spectateurs jusqu’à Buck Island. Appartenant à l’archipel des îles Vierges, l’endroit fut déclaré monument national par John F. Kennedy en 1961. Grâce à l’entremise de Sylvia Earle, Bill Clinton agrandit lui-même la zone à protéger en 2001. Après une incursion à Ewing Bank, dans le Golfe du Mexique, où prospèrent les requins-baleines, l’émission continue au cœur des eaux turquoise de l’archipel d’Hawaï et des îles Midway, un espace protégé par George W. Bush en 2006 sous l’impulsion, une fois encore, de Sylvia Earle qui, en 2016, parvient à obtenir le quadruplement de sa taille par Barack Obama. Enfin, les dernières minutes du documentaire sont consacrées à l’exploration des tréfonds de l’océan, là où la lumière ne filtre plus et où des espèces parfois mystérieuses prolifèrent loin de l’impact négatif des Hommes.

Au fil des pérégrinations scientifiques de Sylvia Earle, les spectateurs découvrent certains des plus beaux espaces marins et sous-marins des États-Unis. L’idée est alors de sensibiliser chacun à l’existence de ces trésors de la nature en dévoilant toute leur splendeur. Peu nombreux sont ceux qui ont – ou auront – un jour la chance de les découvrir de leurs propres yeux. Certains pourraient même douter de leur présence. Dans la droite ligne de ce que William Henry Jackson fit en son temps en photographiant Yellowstone, le but du film est donc de prouver que ces endroits merveilleux existent bel et bien et qu’il faut absolument les sauver. L'objectif est clair : les gens n’attacheront de l’importance à ces paysages que s’ils sont en mesure de les voir, ne serait-ce que par l’intermédiaire de leur écran de leur télévision. La jeunesse, parfois ignorante, est en particulier la cible du documentaire. Les images sont également destinées aux autorités politiques elles-mêmes qui, souvent, ne réagissent pas faute de réellement connaître les enjeux.

L’intérêt principal du documentaire réside dans la qualité incroyable des images qu’il propose. Certaines séquences sont juste magnifiques, à l’image de celle montrant les dauphins en train de « danser » avec les plongeurs. Une jolie poésie se dégage au moment de découvrir l’éclosion des œufs de tortues de mer sur la plage. Les minuscules créatures, qui atteindront quand même un poids de 400 kilos à l’âge adulte, doivent alors lutter pour trouver le chemin de la mer. Les récifs coralliens, avec leurs multiples couleurs, sont splendides. Les phoques-moines – aujourd’hui menacés d’extinction – ou bien encore les murènes sont des espèces rarement mises en valeur au cinéma. Et que dire de la vision incroyable des requins-baleines dont la gueule s’ouvre si grand qu'elle semble être un aspirateur capable d’avaler algues, crustacés, krills et autres petits poissons ? La cerise sur le gâteau reste enfin ces images sous-marines « magiques » montrant la bioluminescence des coraux qui, lorsqu’ils sont touchés, produisent une lumière phosphorescente. « On se croirait dans Avatar », s’exclame l’un des intervenants !

De l’Espoir Sous l’Océan porte particulièrement bien son nom. Si nombre de documentaires ont tendance à adopter un ton pessimiste, il n’en est rien ici. Rayonnante, Sylvia Earle tient en effet un discours parfaitement optimiste. Le visage marqué par un charmant sourire, l’exploratrice, âgée de 81 ans au moment du tournage, invite chacun à ne pas désespérer. Selon elle, il est tout à fait possible de revenir en arrière ou, au moins, de limiter la casse. Si beaucoup d’espèces ont souffert de la prédation des Hommes, si les récifs ont parfois disparu, si les fonds marins portent les stigmates des forages, rien n’est définitif. Le message de l’océanographe n’est jamais culpabilisant. Son attachement à associer les jeunes générations à la gestion des problèmes environnementaux actuels est à saluer. C'est également le cas de son approche, parfaitement didactique et pédagogique, grâce à laquelle elle est parvenue à obtenir beaucoup de la part de Bill Clinton, George W. Bush et Barack Obama, le quarante-quatrième président des États-Unis qui intervient en personne à la fin du documentaire afin de remercier Sylvia Earle pour son engagement.

Remarquable, De l’Espoir Sous l’Océan est diffusé aux États-Unis le 13 janvier 2017. La critique salue alors l’effort. « L’un des accomplissements les moins connus du président Obama – à savoir l’expansion récente du monument national sous-marin de son île natale d’Hawaï – vient enfin de recevoir toute l’attention qu’il mérite grâce au documentaire De l’Espoir Sous l’Océan, note Gary Goldstein dans les colonnes du Los Angeles Times. Le réalisateur Robert Nixon livre un compte-rendu visuellement époustouflant du voyage ambitieux de l’océanographe chevronnée Sylvia Earle. Le film capture la beauté éblouissante de ces paysages océaniques, que ce soit sur ou sous la surface, tout en nous rappelant avec sobriété les enjeux écologiques cruciaux dont les solutions sont à portée de main. Comme le souligne avec justesse un observateur : ‘Si nous n’empêchons pas l’océan de mourir, aucun d’entre nous n’y survivra’ ».

Parmi les premiers contenus accessibles lors du lancement en France de la plate-forme Disney+, le 7 avril 2020, De l’Espoir Sous l’Océan est un très beau documentaire qui, en à peine une heure, parvient à dévoiler une admirable vision des océans. Visuellement splendide, il s’agit surtout d’une très belle leçon d’écologie qui se veut parfaitement optimiste au moment où, pourtant, le bien-être de ce patrimoine semble filer entre les doigts.